 Fondée en 1783, l’Ecole des Mines de Paris a formé des générations d’ingénieurs. A travers le temps, elle a su adapter ses enseignements aux besoins technologiques de son époque à l’évolution de la société.
Fondée en 1783, l’Ecole des Mines de Paris a formé des générations d’ingénieurs. A travers le temps, elle a su adapter ses enseignements aux besoins technologiques de son époque à l’évolution de la société.
Mais une école c’est aussi des élèves et leurs parcours. Nous vous proposons une série de portraits en allant à la rencontre de Mineurs, de différentes générations.
Nous poursuivons notre série avec un portrait de Véronique Jacq ICiv 88 et ICM 91.
Comment et pourquoi avez-vous décidé de devenir ingénieure et d’intégrer l’Ecole des Mines ?
Le modèle de mes parents a été très inspirant, ils sont tous les deux ingénieurs. Ils m’ont montré la voie, en particulier ma mère qui a fait des études d’ingénieur à une époque où peu de femmes se lançaient dans ce type d’études. Elle a fait une carrière de chercheur au CNRS dans des domaines à la croisée de la chimie et de la pharmacie. Dans mon milieu familial, j’ai toujours été encouragée à faire des études supérieures et le choix de faire des études scientifiques a été très naturel. J’avais du goût pour les matières littéraires mais je me sentais beaucoup plus à l’aise en mathématiques ou en chimie. Je n’ai donc pas beaucoup hésité.
D’abord les classes préparatoires à Reims au lycée Clemenceau puis les Mines à Paris. J’ai choisi les Mines plutôt que Centrale Paris. L’Ecole avait une bonne réputation, j’avais demandé leur avis à mes professeurs de classes préparatoires qui m’ont encouragée à faire l’Ecole des Mines. Je me suis dit que ce serait quand même bien d’être à Paris et de profiter du Quartier Latin ! Par ailleurs, plus que dans d’autres écoles, il y avait aux Mines la volonté de développer les sciences économiques et sociales. C’était original à l’époque, on avait des cours de sociologie en tronc commun, tout comme de la finance d’entreprise ou de la comptabilité plus classiques. Cette multidisciplinarité qu’on retrouvait aussi dans les options me semblait un des atouts de l’Ecole.
Vous avez intégré l’Ecole des Mines en 1988, que vouliez-vous faire avec votre diplôme à la sortie ?
Je n’avais pas d’idée arrêtée, si ce n’est de mettre en application les connaissances apprises à l’Ecole dans un métier d’ingénieur. Je voulais mettre en pratique ce que j’avais appris dans les sciences de l’ingénieur. J’aurais trouvé étrange de plonger dans le monde de la banque et du financement d’entreprises à la sortie de l’Ecole, même si mon parcours m’y a menée depuis…
Quel a été votre parcours au sein de l’Ecole ?
J’ai eu un parcours plutôt classique avec une spécialisation en sciences des matériaux et cela m’a permis notamment de faire un stage chez Saint-Gobain. Je suis partie pendant trois mois aux Etats-Unis dans une usine de fabrication de matériaux réfractaires, perdue au fin fond d’une vallée de l’Etat de Virginie-Occidentale. Cela a été une expérience très riche avec la découverte de la vie dans une entreprise industrielle et aussi de la culture américaine, j’étais complètement immergée dans la vie locale, seule Française travaillant dans cette usine, et très vite intégrée à la communauté de personnes travaillant dans l’entreprise. J’en ai gardé un souvenir vraiment très fort, très heureux.
Et qu’avez-vous fait à la sortie ?
J’ai fini mon parcours d’Ingénieur civil, puis j’ai intégré le Corps des mines. Au-delà du cursus de 1988 à 1991, j’ai donc poursuivi mon parcours jusqu’en 1994 avec une formation très fortement pondérée par des stages en entreprise qui représentaient deux années sur les trois années de formation. Mon premier stage m’a menée en Allemagne chez Usinor et mon second stage chez Renault à la direction commerciale installée à Boulogne. Ces deux longues périodes de stage ont été très formatrices, et j’ai beaucoup apprécié, pendant ces trois années, les allers-retours stimulants entre les usines ou les bureaux d’étude de l’entreprise et les bancs d’école où nous avions des cours et régulièrement des conférences sur des thèmes variés.
A la fin du Corps des mines, j’ai commencé mon parcours professionnel à l’Autorité de sûreté nucléaire dont j’ai rejoint le département chargé de contrôler les réacteurs nucléaires de puissance, en clair les réacteurs d’EDF. C’était donc un début de parcours qui répondait parfaitement à mes attentes : difficile d’imaginer une industrie où autant de sciences et de technologies sont mobilisées à la fois ! Depuis la neutronique jusqu’à la mécanique des fluides, en passant par le génie civil ou les sciences humaines avec toutes les problématiques liées aux erreurs humaines dans la gestion ou la maintenance des installations.
J’ai quitté le monde du nucléaire six ans plus tard, en 2003, pour rejoindre l’Anvar, cette agence n’existe plus aujourd’hui car elle a été fusionnée avec Oséo, elle-même absorbée par Bpifrance. L’Anvar était une agence qui était chargée de soutenir la R&D et l’innovation dans les entreprises. C’est le fil rouge de mon parcours professionnel par la suite : se trouver à la croisée de la technologie et de la finance d’entreprise. L’agence était chargée de stimuler l’innovation dans les entreprises, elle le faisait en soutenant, par des financements en avance remboursable ou subvention, les projets les plus prometteurs proposés par les entreprises. Notre analyse s’intéressait aux aspects technologiques mais aussi aux potentialités en termes de marché. C’est là où j’ai commencé à découvrir et apprendre le métier qui est le mien aujourd’hui, financer et accompagner des entreprises technologiques.
Vous travaillez à Bpifrance qui est plus sur un versant financier qu’ingénieur, quels acquis de l’Ecole vous ont aidé dans votre parcours professionnel ?
Chez Bpifrance aujourd’hui, je pilote l’activité d’investissement en capital-risque dans les startups technologiques. C’est une activité que j’ai lancée en 2011 d’abord chez CDC Entreprises, filiale de la caisse des dépôts, puis chez Bpifrance lorsque la banque publique d’investissement a été créée en 2013. Avec mon équipe, nous avons la capacité à détecter très tôt des startups proposant des solutions innovantes et à fort potentiel de croissance. Nous les identifions dès le tour d’amorçage, juste après la création de la startup, ou aux tours suivants. Nous recherchons des entreprises qui ont le potentiel de devenir leader sur leur marché, et donc nous recherchons une combinaison entre une solution très innovante, le plus souvent basée sur des innovations technologiques, un besoin identifié pouvant constituer un marché important et une équipe capable de porter cette ambition. Chez Bpifrance, nous pouvons soutenir des paris très ambitieux grâce à notre capacité d’investissement importante et à une vision à long terme, qui nous permet d’accompagner les entrepreneurs dans la durée.
Pour faire ce métier, des compétences variées sont nécessaires. Au-delà du savoir-faire financier et juridique, il faut savoir évaluer des technologies et également savoir évaluer la qualité des équipes que nous rencontrons. Je mobilise donc des connaissances très variées, qui ne se réduisent pas, de loin, à des connaissances sur la finance d’entreprise, mais aussi des connaissances sur les technologies, sur le processus qui conduit de la première version d’un produit technologique à une solution commercialisée en masse sur un marché.
Quels liens gardez-vous avec votre promotion ?
J’ai des liens avec une petite dizaine d’élèves et des liens d’amitié très profonds avec certains. On se voit très régulièrement.

Réunion de promotion de la P88
Comment avez-vous vécu vos années à l’Ecole des Mines à une époque où l’Ecole venait de s’ouvrir au recrutement de femmes ?
Je n’ai pas ressenti de difficultés particulières dans ma scolarité sur ce plan, nous étions effectivement peu de filles à l’Ecole, mais l’ambiance était très bonne. Je pense qu’en tant que filles, nous étions très fières d’avoir suivi un parcours scientifique.
Dans mon parcours professionnel, je pense avoir été privilégiée et ne pas avoir souffert d’être une femme à aucun moment. Le passage par le Corps des Mines a agi comme un accélérateur dans ma carrière en me donnant très vite des responsabilités sur des équipes et sur des projets. J’ai pu ainsi rebondir d’un poste à l’autre, en gagnant à chaque fois plus d’expérience et de compétences dans de nouveaux domaines et donc plus de crédibilité.
Je conçois cependant que des femmes puissent ressentir des freins dans leur parcours professionnel. En tant que manager, je suis très attentive à ma politique de recrutement et, puisque j’ai eu la chance de pouvoir recruter toutes les personnes qui composent aujourd’hui mon équipe d’investissement, j’ai eu à cœur de trouver un équilibre entre des profils féminins et des profils masculins. Mon équipe est aujourd’hui strictement à la parité. C’est atypique dans le domaine du capital-risque puisque les femmes n’y représentent pas plus de 20% des investisseurs. Des équipes pilotées par des femmes, c’est encore plus rare !
Je suis convaincue que les échanges sont plus sereins, plus féconds dans une équipe qui mêle des femmes et des hommes, cela vaut pour n’importe quel domaine. Dans mon métier, une composante importante de notre décision d’investissement relève de l’évaluation que nous faisons de la qualité de l’équipe dirigeante. La mixité de notre équipe évite, je crois, des biais qui pourraient exister dans notre jugement, liés au genre des porteurs de projet. Nous avons pu financer de nombreuses entreprises portées tant par des hommes que par des femmes, plus de 90 startups depuis le lancement de l’activité. Je constate que les femmes peuvent porter des projets tout aussi ambitieux que les hommes, et qu’elles arrivent à mener de front leur vie professionnelle et leur vie personnelle, sans impact sur la vie de l’entreprise. Ce qui compte, c’est plus la qualité de l’entourage de la dirigeante ou du dirigeant, une entreprise qui fonctionne bien est portée par une équipe de personnes compétentes, qui se complètent et qui s’entendent bien.
Quels souvenirs marquants gardez-vous de votre passage à MINES ParisTech ?
La solennité de la journée d’accueil dans le grand amphi.
J’ai aussi en tête des moments plus festifs, notamment le weekend d’intégration, les concerts organisés avec d’autres élèves de la promo dans la salle aux colonnes. C’est à cette époque que j’ai noué des liens avec les élèves musiciens de la promo parce que je fais du piano. J’avais arrêté pendant la classe prépa et je m’y suis remise avec beaucoup d’enthousiasme. C’étaient des moments de grand plaisir, nous passions des soirées au sous-sol de la maison des mines où se trouvait le piano avec des amis musiciens, notamment une très bonne amie qui faisait du chant, et qui m’a fait beaucoup progresser en déchiffrage à la volée ! J’en ai de très bons souvenirs, beaucoup de joie et de fous rires !
Etiez-vous à la Maison des Mines ? Que vous a apporté cette vie en communauté ?
J’y ai vécu de très bons moments d’amitié, de bavardages, de rires les uns avec les autres. J’avais vécu la prépa comme deux années de vie monacale où je ne faisais que bosser et je n’avais qu’une hâte, c’était de faire autre chose, faire des rencontres, retrouver des amis, faire de la musique avec d’autres amateurs comme j’ai pu le faire avec bonheur à la Maison des mines.
Vous avez accompagné le ClassGift P18 en 2020 et êtes donatrice de la Fondation. Pourquoi choisissez-vous de soutenir les projets de la Fondation ?
J’ai été très heureuse d’être marraine du projet ClassGift porté par les élèves de la promotion 2018. Je trouve formidable que les jeunes promotions s’investissent dans la transformation de leur Ecole. Notre école doit vivre et se renouveler, et les élèves qui la fréquentent tous les jours sont bien placés pour imaginer les transformations dont elle a besoin. Quand je suis venue visiter la salle des boîtes aux lettres avec les élèves, je me suis rendu compte que ça n’avait pas vraiment changé. Ça ne donnait pas une image de l’Ecole très moderne, ni très accueillante. En discutant de leur projet avec les élèves, j’ai trouvé leurs idées très pertinentes, le projet permettant de créer un lieu plus ouvert, avec une circulation plus facile vers la bibliothèque, les salles de cours ou le jardin, et aussi plus accueillant avec des espaces pour s’assoir et pour discuter. J’espère que cela pourra devenir un espace agréable pour les élèves et tous ceux qui viennent et travaillent à l’Ecole. J’ai également été impressionnée par la ténacité des élèves qui ont gardé le cap pour faire avancer leur projet malgré les vents adverses de la crise de 2020. Et j’ai été ravie de pouvoir les accompagner !

 L’École a fait de la mixité un de ses axes stratégiques. Pourquoi ? Parce que les entreprises ne cessent de se plaindre d’un manque de talents, et qu’il est donc bien dommage dans ce contexte de se passer de la moitié d’entre eux. Or les écoles d’ingénieurs et d’ingénieures, à l’exception des écoles d’agronomie, restent sous féminisées. Il faut donc convaincre les jeunes femmes qu’elles ont leur place dans ces écoles et qu’elles ont les mêmes capacités que leurs homologues masculins. Le documentaire qui devrait être achevé dans les prochaines semaines doit leur montrer les multiples carrières possibles de celles qui ont fait le choix d’une formation d’ingénieure, leur intérêt et leur possible contribution à la construction d’un monde meilleur et durable.
L’École a fait de la mixité un de ses axes stratégiques. Pourquoi ? Parce que les entreprises ne cessent de se plaindre d’un manque de talents, et qu’il est donc bien dommage dans ce contexte de se passer de la moitié d’entre eux. Or les écoles d’ingénieurs et d’ingénieures, à l’exception des écoles d’agronomie, restent sous féminisées. Il faut donc convaincre les jeunes femmes qu’elles ont leur place dans ces écoles et qu’elles ont les mêmes capacités que leurs homologues masculins. Le documentaire qui devrait être achevé dans les prochaines semaines doit leur montrer les multiples carrières possibles de celles qui ont fait le choix d’une formation d’ingénieure, leur intérêt et leur possible contribution à la construction d’un monde meilleur et durable. Intéressée depuis de longues années par cette problématique de l’accès des femmes aux postes de responsabilité, je suis ravie de piloter le groupe de réflexion de la fondation sur ce thème, et remercie vivement les participants et participantes pour leur ouverture d’esprit, leur apport méthodologique pour bâtir à l’École des Mines de Paris, une formation d’excellence dans ce domaine, et pouvoir appliquer à la mixité la devise de l’école : Théorie et pratique.
Intéressée depuis de longues années par cette problématique de l’accès des femmes aux postes de responsabilité, je suis ravie de piloter le groupe de réflexion de la fondation sur ce thème, et remercie vivement les participants et participantes pour leur ouverture d’esprit, leur apport méthodologique pour bâtir à l’École des Mines de Paris, une formation d’excellence dans ce domaine, et pouvoir appliquer à la mixité la devise de l’école : Théorie et pratique.

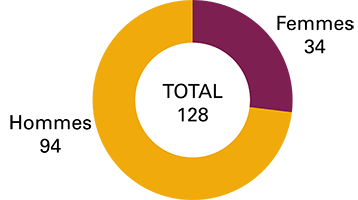
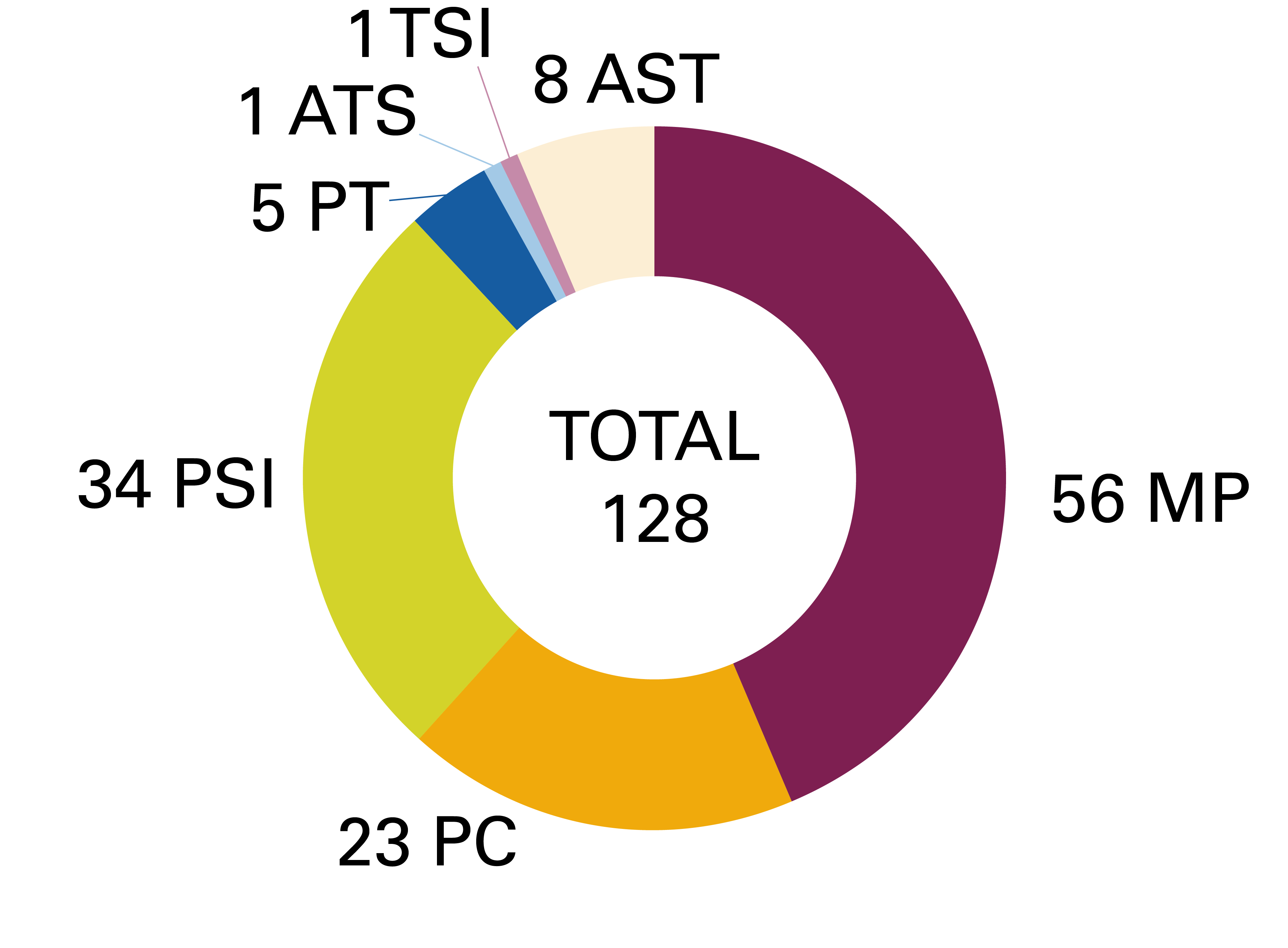
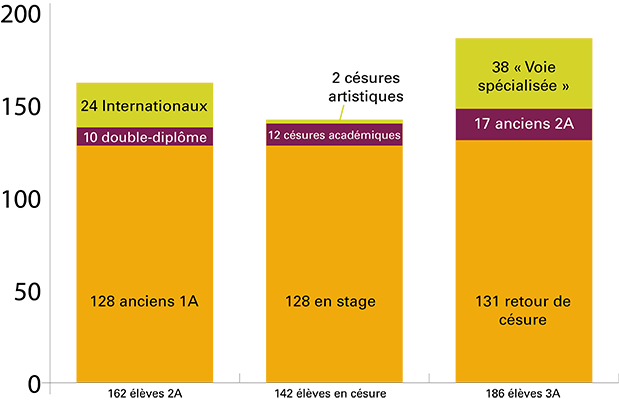


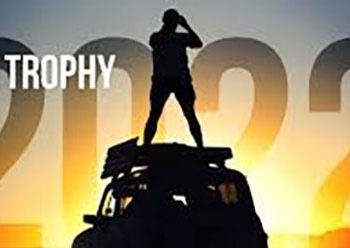



 Fondée en 1783, l’Ecole des Mines de Paris a formé des générations d’ingénieurs. A travers le temps, elle a su adapter ses enseignements aux besoins technologiques de son époque à l’évolution de la société.
Fondée en 1783, l’Ecole des Mines de Paris a formé des générations d’ingénieurs. A travers le temps, elle a su adapter ses enseignements aux besoins technologiques de son époque à l’évolution de la société.



